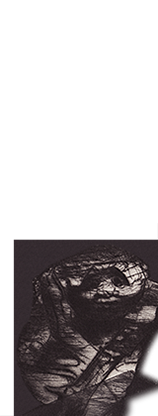Dado par Françoise Choay
Dado, au-delà du récit
Ce texte de Françoise Choay est initialement paru en mai 1971 dans le numéro 102 de la revue Cimaise.
Cliquer sur les images pour les agrandir
en grand et très grand formats
❧
Diaporama
plein écran

Depuis 1960, l’année où il peignit le décisif Thomas More – pétrifié et boursouflé, marqué par les mille rides d’une maladie déconstructive – Dado a tracé sa voie dans le champ de la peinture, tout droit, sans que l’événement ou l’incident l’arrêtent ou le détournent. Inatteint par le pop, le nouveau réalisme, les arts optique ou conceptuel, il poursuivait sa route – solitaire – rêvant d’abord, dans des dessins innombrables comme une production de la nature, un univers où se confondent les règnes, à la fois végétal et animal et pétrifié.
Cet isolement a fait situer Dado « en marge », dans la tradition et la lignée d’un art fantastique prétendument éternel… sorte de folklore pictural des profondeurs. Sous cette étiquette, on a notamment rapproché ses visions de celles de Jérôme Bosch ou Pierre Breughel, en se laissant prendre au piège par les identités de surface : la tératologie et l’insolite, et la précise propreté du cruel, sans se soucier de ce qui signifie le tableau : son espace et son ordre.

Davantage, Dado a pu être classé parmi les raconteurs dont l’activité rassurante est aujourd’hui reléguée par l’avant-garde dans une constellation du savoir avec quoi elle a rompu. Et en effet, ces monstres minéralisés ou emplumés, ces fœtus aux contours de légumes, tout ce peuple qui grouille dans des paysages fendillés où l’on identifie sans peine l’environnement du peintre, ne sont-ils pas pris dans une histoire commune ? L’hôpital de Gisors, les murs du Vexin, les fermes, les rats et les fleurs d’Hérouval, comme la grave bretonne découverte en 1969, ne sont-ils pas la référence explicite et comme la condition d’un récit ?
Telle est bien l’illusion du premier abord. Peut-être parce que les tableaux de Dado sont indéfiniment descriptibles. D’ailleurs on souhaiterait qu’une fois, un des artisans du nouveau roman tente la saisie scripturale d’une de ses toiles, jusqu’à l’épuisement : écrive mille pages sur Les Polonais (1959) – ces faces rondes, infantiles, œdémateuses, citrouillesques, éteintes, mutilées, couvertes de verrues, terriblement précises et presque évanescentes sur la surface qu’elles remplissent, sans un vide, jusqu’aux bords – ou bien Le Bus Palladium (1965) – accumulation de corps difformes, aux crânes disproportionnés, jamais deux semblables, dans la multitude où ils surgissent, debout, pliés, sautant, proches, lointains, isolés, groupés suivant des ombres et des courants. Mais qu’on y prenne garde, dès que le descripteur tente de cerner ou d’orienter les cohortes du Bus Palladium, à l’instant même où il s’apprêtait à dire apocalypse, montée au calvaire, résurrection des morts, muséum d’histoire naturelle, camp de concentration, il s’arrête, car l’interprétation se refuse. Le fourmillement des formes et des signes peut bien être décrit aussi minutieusement qu’on voudra, rien ne fera qu’on le puisse organiser sous une forme séquentielle, il ne s’offre à aucun récit.

Ainsi donc, au contraire de l’apparence, la peinture de Dado est accordée à l’extrême pointe de la réflexion actuelle. Elle s’est installée par ses moyens propres et, il faut bien dire, paradoxaux, dans le grand basculement de la représentation. Pour peu qu’on y regarde de près, on peut, dès ses débuts, situer l’œuvre de Dado sous le double signe de la déconstruction et de la trace. Déconstruction d’abord métaphorique, qui commence par être le sujet même de tableaux encore construits selon la logique du sujet, et de la représentation, tel Le Cycliste de 1955, cet automate juché qui perd ses pièces et ses boulons. Dé-construction qui, peu à peu, se dé-figure pour « avoir lieu », se présenter, selon une progression qui mène de L’Architecte (la dénomination même est signifiante) de 1959, tout fissuré sur son fauteuil roulant, aux architectures croulantes (maisons éventrées, murs ruinés, voies désagrégées) et à la chair plus pierreuse que pétrifiée des monstres humanoïdes et des végétaux. Peinture de la trace aussi, disions-nous, et qui d’emblée se manifeste dans la dialectique de l’effacement, dans le jeu du graphisme aigu et des couleurs tendres.

huile sur toile, 195,5 × 81 cm.
Courtesy Stedelijk Museum Amsterdam.
Épisodiques, mais constants depuis les débuts de Dado, ces moments allègres d’abandon, ceux où Dado côtoie le surréalisme, sont d’un intérêt extrême. Parce qu’ils éclairent le mode de production de l’œuvre en livrant son envers (ce contre quoi elle s’affirme), parce qu’ils en font saisir l’ambiguïté et la pointe vertigineuse où elle s’inscrit. Aussi, parce qu’ils permettent de mieux mesurer la difficulté de la démarche de Dado et la différence de son œuvre dans le grand mouvement qui tente de libérer la peinture du sujet, de l’homme, et du texte verbal : faire surgir un imaginaire initiateur, n’est-ce pas à la fois plus périlleux – puisqu’il faut sans trêve se défendre des images de la tradition qui illustrent et représentent – mais, plus efficace (de toute la puissance iconique), que de se condamner à la pure ascèse, à la pauvreté de signes pauvres qui, finalement, appellent de nouveaux discours et une nouvelle littérature.
La dernière exposition de Dado semble marquer une étape dans la conquête par le peintre de son propos et de son historicité. Historicité qui consiste, paradoxalement, à faire délivrer à cette peinture un monde infra-historique, le monde du minéral, du végétal, des ratés de la nature et des proliférations de l’inconscient, contre quoi les humains tentent de se rassembler.
Les monstres qui, depuis l’époque des premiers bébés fœtaux et à travers des avatars multiples, ont été chez Dado un des moyens opérants de sa présentation, les monstres ont retrouvé leur présence massive et globale, précise et indistincte, un moment abandonné à l’époque des plages semées d’êtres solitaires où la recherche du peintre semblait dominée par un problème d’espace : trouver un ordre de la présentation qui ne fut ni celui de la perspective classique, ni celui de la juxtaposition naïve des formes sans illusion de profondeur, ni celui de la suppression des vides (toutes organisations épuisées par Dado). En 1969, à l’époque des plages, Dado tentait une superposition de plans, parallèles au bas du tableau, la dernière bande étant occupée par le ciel. Nul doute que ce découpage n’ait constitué une étape vers la solution actuelle qui en intègre magistralement la leçon de géométrie. L’invention de Dado, c’est une sorte de vaste plan incliné qui constitue comme le moyen d’une perspective inversée (éclatant vers le spectateur) et sert désormais de scène et de sol au tableau. Cette plate-forme, ou dallage, ou voie de passage (construite et dégradée) semble servir un double propos : impliquer plus directement le lecteur, le menacer en somme, dans un glissement qui entraîne et oriente vers lui la présentation ; en désimpliquer au contraire plus complètement le peintre en tant que subjectivité. Car cette mise en scène et cette contre-perspective lui permettent de prendre une distance nouvelle par rapport à son tableau.
Et sur le sol dangereux qui à la fois accueille les traces et les efface en s’effritant, l’objet familier et quotidien minutieusement décrit et représenté et qui, bâtisses, meuble, vêtement… a toujours place dans les tableaux de Dado, prend enfin sa pleine valeur et son sens. Le pourquoi du café-tabac de Gisors, d’une niche à chiens ou d’une vieille galoche, nous le saisissons enfin au plus près, dans une toile comme La Chambre d’enfants : les deux petites chaises délabrées sont l’allusion, l’indice, dans la représentation, d’un monde qui n’est ni un cadre, ni un décor, mais un fragment déjà fragmenté.

Étrange tableau que cette Chambre d’enfants. Plus accompli peut-être encore que le Réveillon (où le rôle des chaises est joué par des bouteilles) ou le Ménage, plus baroque avec son seau, sa brosse et son bidon. La Chambre d’enfants est sans doute un tableau-étape (comme autrefois Thomas More) qui permet de mesurer le chemin parcouru : présentation délivrée des habitudes du regard, logée enfin dans une structure d’espace qui lui est propre ; déconstruction plus libérée de la métaphore ; représentation plus complètement intégrée dans ce qui la nie.
Ainsi Dado a su rompre l’antique clôture qui emprisonne la peinture et s’est, par là même, situé à la pointe de l’art contemporain. Passé la trompeuse évidence de ses monstres et les séductions de sa palette, cette œuvre – une des plus importantes de ce temps – demeure aussi l’une des plus difficiles. Présentation cruelle – tératologie et cataclysmes – mais sereine pourtant par absence du je peignant, il semble que la mise en scène inversée de Dado se soit fixée pour précepte celui même d’Artaud définissant le théâtre de la cruauté : « Le théâtre doit s’égaler à la vie, non pas à la vie individuelle, à cet aspect individuel de la vie où triomphent les CARACTÈRES, mais à une sorte de vie libérée, qui balaye l’individualité humaine et où l’homme n’est plus qu’un reflet ».
Françoise Choay