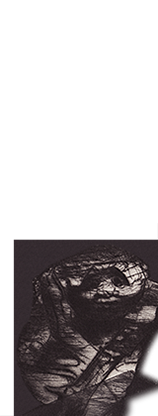Brûler les morts
Le texte est extrait d’une nouvelle éponyme d’Amarante Szidon, fille de l’artiste. Les photos ont été prises par Jorge Amat en 1988 quelques jours après l’incendie de l’atelier de Dado à Hérouval.
Cliquer sur les images pour les agrandir
en grand et très grand formats
❧
Diaporama
plein écran
Jean-Sébastien Bach, Passion selon saint Jean – Christus, der uns selig macht
Ramin, Thomanerchor Leipzig, Gewandhausorcherster, 1956


Pendant l’été, profitant de l’avancée des fauteuils du Cabinet d’histoire naturelle, mon père avait aménagé l’atelier en y réalisant une petite mise en scène ; les fauteuils avaient été disposés en cercle comme s’ils étaient destinés à recevoir des visiteurs. En vérité, personne n’osait jamais s’y asseoir ; on les contournait avec prudence, ainsi qu’on marche dans un champ de bataille couvert de cadavres, pour ne pas trébucher sur un membre arraché. Au fur et à mesure des semaines, il devenait évident que les invités tant attendus n’étaient autres que les créatures peintes, dont on entendait presque le souffle à travers le cuir ou les fibres du tissu. Le plus souvent, ce sont des yeux et une bouche qui ont surgi sur la face la plus visible du fauteuil, à l’endroit même où ceux qui les ont possédés se sont adossés. Avec les fauteuils, mon père s’amusait à provoquer des résurrections troubles, à faire parler les morts. Les fauteuils du Cabinet d’histoire naturelle étaient ses hôtes anonymes, qu’il accueillait comme des réfugiés dans la chapelle de son atelier. Fantômes immobiles, ils n’ont ni nom, ni sexe définis, et il m’arrivait de les entendre dialoguer à voix basse avec les autres présences invisibles, qui attendaient non sans frayeur leur incarnation par la main du maître. Depuis toujours, au moulin d’H., circulent ces présences invisibles, sources de terreurs enfantines diurnes, qui, la nuit, restent calmes et silencieuses. Avec les fauteuils, quelques-unes ont pu s’incarner après des années, des décennies peut-être, de flottement dans le vide. À mon grand soulagement, d’ailleurs : le face à face devient enfin possible ; dans l’atelier du moulin d’H., j’ai désormais des prises auxquelles m’accrocher.



Mon père part le premier ; au lieu de longer l’étang comme d’habitude, il prend le chemin en pente, surplombé d’un mur en pierres, qui conduit jusqu’à la cave. Je lui emboîte le pas, mes jambes sont un peu flageolantes, je les devine peu assurées à cause du béton sous mes pieds qui m’a toujours été hostile – des pas trop précipités, des chutes évitées de justesse –, et de la mousse verte qui pousse sur le mur – principale source d’inspiration de mes cauchemars pendant l’adolescence. Sur le chemin, un couple de chats me frôle en miaulant d’agacement, pressé de poursuivre ses ébats interrompus par notre venue. Devant l’atelier, la pelouse est couverte de plumes d’oies mêlées aux cendres et aux gravats de l’incendie ; les plumes comme les fragments de duvets sont devenus sales et lourds. Le sol est maintenant hanté ; je ne l’ai jamais vu sous ce visage. J’arrive ensorcelée devant la porte de l’atelier, qui a déjà été repeinte par mon père ; les carreaux de sa partie supérieure reflètent le soleil grave d’automne. Les toutes dernières feuilles du poirier, clairsemées sur les branches, forment des ombres qui se soulèvent doucement sur la porte, sous l’action de la respiration ténue de l’air environnant.



Arrivée au seuil, j’hésite un instant, à l’écoute de cette respiration. La main tremblante, je soulève avec précaution la poignée. Mes doigts se couvrent de traces de l’incendie, qui y étalent d’infinies nuances, transformant ma main en un éventail calciné. à l’intérieur, l’obscurité s’est installée pour une durée indéterminée. La poussière des cendres est retombée sur les fauteuils, les pinceaux, les tubes de peinture laissés à l’abandon sur la planche qui fait office de palette. Elle a même conquis les murs, où elle s’est collée comme une seconde peau. Malgré cette nouvelle atmosphère humide et froide, l’obscurité n’a rien d’inquiétant ; on se sent vite à l’aise en sa compagnie, parce qu’elle est presque reposante par rapport à la lumière métallique du dehors et qu’elle vous plonge à votre insu dans une sorte de sommeil. Très vite, une torpeur sourde enveloppe tout mon corps, tandis que mes yeux s’habituent à l’obscurité, et parviennent à distinguer les formes mobiles des formes immobiles. Mobiles, la silhouette de mon père, celle de ma sœur, tout à côté, comme son ombre, surgie de nulle part ; immobiles, les autres fauteuils, une baignoire hors d’usage, le poêle trempé, des seaux vides, renversés sur le plancher. Les toiles, elles, ont dû être mises ailleurs, car elles n’y sont plus. Abîmées, sans doute par le feu, puis par l’eau salvatrice projetée par les colosses en uniforme.

Le fauteuil intact est placé à l’extrémité du mur principal, là où siégeaient auparavant les toiles destinées à être exécutées. Mon père disparaît ensuite dans la pièce d’à côté. Je me tiens toujours à l’entrée de l’atelier ; ma sœur m’invite à la rejoindre en me hélant avec de grands gestes et en prononçant des paroles rendues inaudibles par un bruit de fond que je ne parviens pas à identifier. Je gravis le petit escalier ; alors que je marche sur le plancher humide et glissant, mon pied bute contre des pots de peinture vides, échoués au sol, trempés et noirs. Arrivée à la hauteur de ma sœur, je m’adosse sur le devant de l’ancien poêle, face au mur principal. Mon haut-le-cœur s’est presque complètement dissipé ; je suis prête pour la communion des cœurs au milieu des cendres.

Ce que j’ai pris pour un bruit de fond n’est autre que la Passion selon saint Jean, jouée par un magnétophone installé dans la pièce à côté. Une Passion que je connais déjà par cœur, au point de m’en réciter le texte chanté pendant mes rêveries : le chœur final de la première partie m’a toujours paru sublime par le silence qui le précède. Les membres pétrifiés, la respiration coupée, je guette ce court moment de silence absolu qui vous épouvante par sa foi sans issue, et le chœur qui le brise, comme un arrachement à la langue des mortels. Dans l’atelier calciné, les voix qui scandent Christus, der uns selig macht résonnent jusque dans les nuées. Leurs courbes ascendantes épousent les barreaux rouillés des échelles posées contre le mur noirci ; de hauteur inégale, les trois échelles ouvrent directement sur le ciel au bleu intense. Je ne les ai pas remarquées en entrant, peut-être parce qu’elles se confondent avec le mur calciné et qu’elles ne sont visibles qu’en leurs extrémités ; c’est mon père qui a eu l’idée de les déposer là, au cas où. Je pense qu’elles ne serviront jamais à rien à H. ; et que d’ailleurs elles ne sont pas destinées à servir à quoi que ce soit. Les échelles rouillées de l’atelier signifient ce monde que je ne fais qu’entrapercevoir à travers les derniers barreaux. Le chœur s’éteint ; la cassette s’arrête avec un clic caractéristique ; ce sont désormais les voix humaines qui reprennent, avec et sans l’incendie.